trajets littéraires
Littérature, Imaginaire et Inconscient: promenade au pays du non-dit



![The-Climax,-illustration-from-'Salome'-by-Oscar-Wilde,-1893-large[1]](https://trajetslitteraires.files.wordpress.com/2013/12/the-climax-illustration-from-salome-by-oscar-wilde-1893-large1.jpg?w=800)
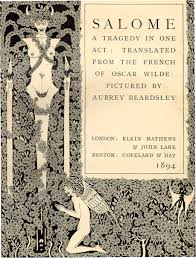
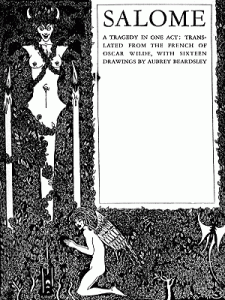
![princessepalatine[1]](https://trajetslitteraires.files.wordpress.com/2013/09/princessepalatine15.jpg?w=106&h=150) La princesse Palatine le savait : tout chieur ne chie point toujours à son aise mais ce qui compte à la fin est de ne point faire « ch… » son lecteur et finalement l’on est bien récompensé de sa peine quand d’un « étron » durement « chié » on peut tirer quelques lignes délicieuses qui lui survivront de très loin.
La princesse Palatine le savait : tout chieur ne chie point toujours à son aise mais ce qui compte à la fin est de ne point faire « ch… » son lecteur et finalement l’on est bien récompensé de sa peine quand d’un « étron » durement « chié » on peut tirer quelques lignes délicieuses qui lui survivront de très loin.![phchat12[1]](https://trajetslitteraires.files.wordpress.com/2013/08/phchat1216.jpg?w=800&h=342)